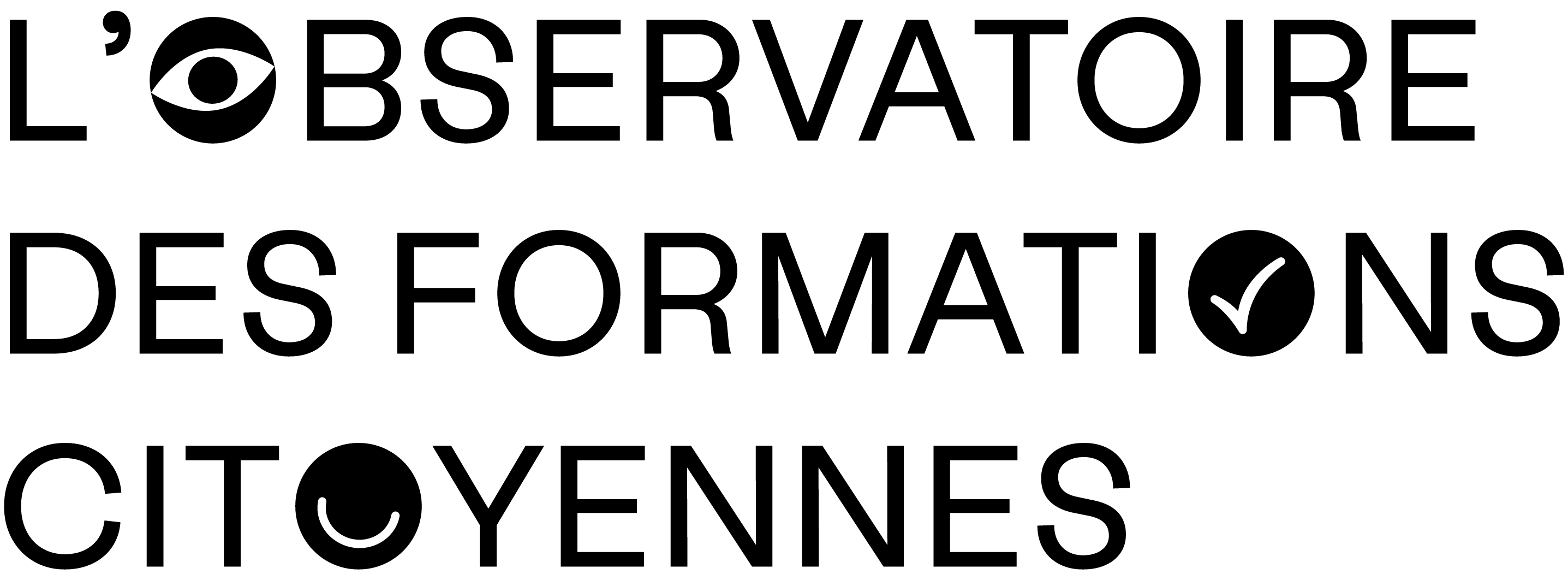
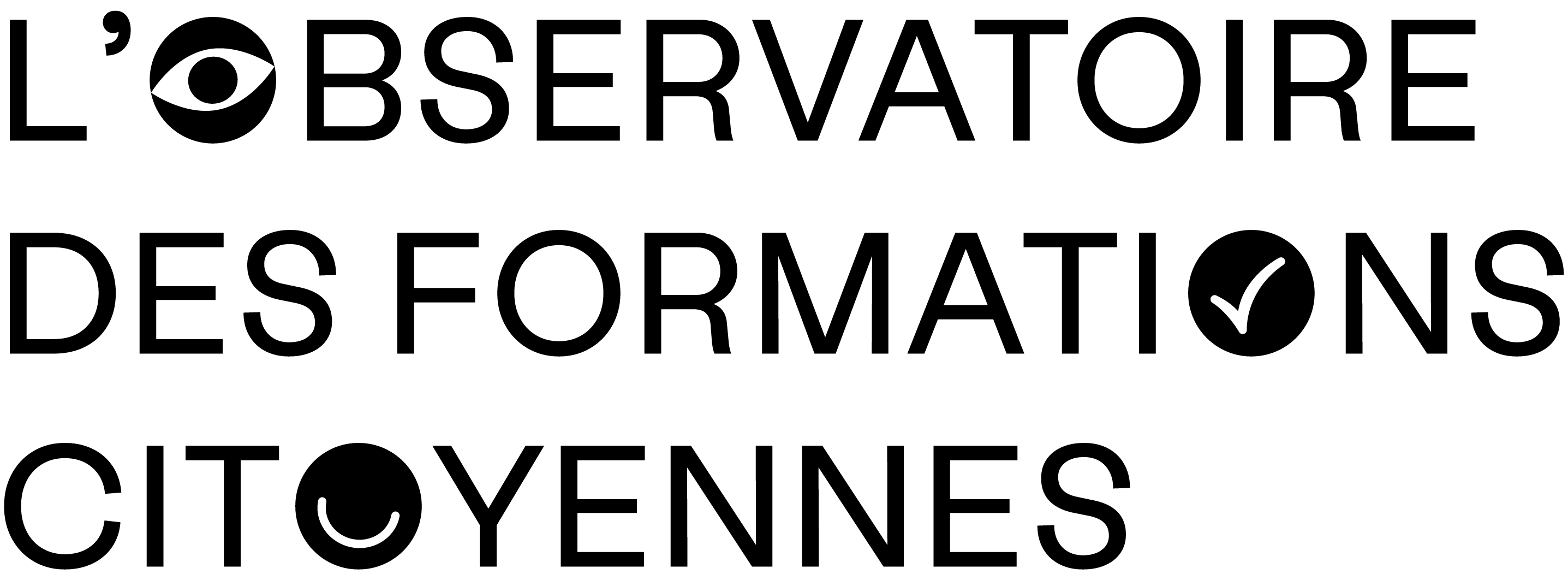
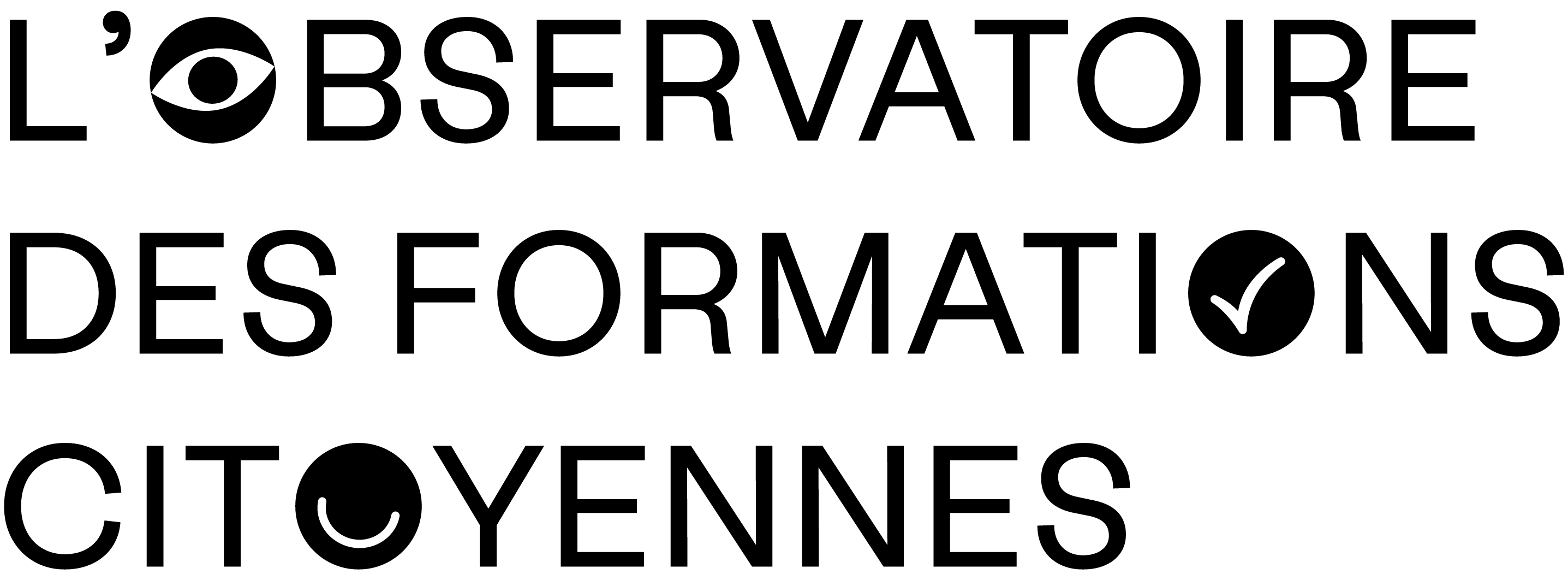
En s’associant avec le monde de la recherche, l’Observatoire s’appuie sur une méthode en sciences humaines et sociales : la recherche-action. En principe, elle se déploie sur une phase de recherche, afin de comprendre une situation, et plus particulièrement les relations qu'entretiennent les acteur·rices de la situation, puis sur une phase d'action, dans laquelle la compréhension de la situation est mise en débat avec l'ensemble des acteur·rices afin d'identifier en commun les problèmes pour mieux les résoudre en respectant les besoins de chacun·e.
Qu’il s'agisse de conflits d'intérêt entre différents acteur·rices, de controverses entre représentations différentes de la situation, d'insatisfactions qui n'auraient pas été entendues jusqu'à présent, … la compréhension de la situation permet à l'ensemble des acteur·rices de s’accorder sur une représentation commune de la situation, de projeter des scénarii pour sa transformation afin d’expérimenter des solutions pour trouver la plus satisfaisante pour tou·tes.
Différentes méthodes existent pour collecter des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, et qu'elles concernent les actions des participant·es ou les relations et les stratégies qu’elle·ils construisent pour les conduire, les connaissances et les opinions qu’elle·ils adoptent ou les valeurs et les intérêts qu'elle·ils portent. Faire appel à différentes méthodes permet d'observer un même objet – ici, la formation – sous différents angles.
Une fois produites, les données sont analysées dans le cadre des concepts choisis, ce qui conduit à expliquer les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec le cadre conceptuel choisi. Les interprétations des résultats d’enquête peuvent amener à mieux percevoir et comprendre les désaccords entre les étudiant·es, les personnels de l’école, sur la vision d’un·e ingénieur·e idéal·e, ou encore à mesurer les écarts entre les objectifs de formation et les acquis des étudiant·es.
Au delà de d'observation et de l’analyse d’une situation, les méthodes d’enquête déployées permettent d'interpeller les personnes qui participent à ce travail, d’enquête en les amenant à se poser de nouvelles questions.
Un conseil scientifique permet d'assurer la pertinence de la démarche mise en place dans les école : Liste des membres du conseil scientifique
Questionnaires
Le questionnaire demande peu de temps aux participant·es et permet de toucher beaucoup de personnes, mais il ne leur offre que peu de liberté dans les réponses. Il nécessite par contre un long temps de préparation pour les enquêteur·rices.
Entretiens
L'entretien permet de saisir la complexité des situations vécues par les acteur·rices. En collectif, il rend compte des interactions entre les personnes.
Collecte de documents
Collecte des sites internet, des maquettes de cours, de l’évaluation CTI, ...
Questionnaires
L’analyse du questionnaire se fait par traitement statistique qui permet de croiser les données obtenues (variables dépendantes) avec certaines caractéristiques identifiées (variables indépendantes, telle que l’année de formation par exemple pour les étudiant·es).
Entretiens
L’analyse des entretiens se fait par analyse de contenu qui révèle les différentes positions des participant·es sur les thèmes étudiés, elle peut conduire à une catégorisation de profils types.
L'analyse de contenu permet également de traiter les informations des sites internet, des maquettes de cours, de l’évaluation CTI… en identifiant des éléments de langage et leur récurrence, la référence à certaines valeurs…
Afin de favoriser la prise en main de ces outils, vous pouvez télécharger le guide d’animation et la maquette de cours ci-dessous
Appuis conceptuels
Les appuis conceptuels rendent l’agencement des données cohérent afin d’en faciliter leur restitution et la comparaison entre les différentes écoles.
Du fait qu’elle interpelle les participant·es, l’enquête va susciter leur intérêt et leur curiosité : elle leur donnera peut-être envie d’aller plus loin et d’investir davantage la démarche. La restitution des résultats de l’enquête est une étape supplémentaire ; plusieurs supports peuvent servir à les transmettre (rapport envoyé par mail, panneaux d’affichage dans l’école, présentation lors d’une conférence).
Pour aller plus loin, ces résultats pourraient être discutés à minima dans les instances de gouvernance de l’école, et dans l’idéal avec l’ensemble des acteur·rices de l’école à l’occasion d’un événement à l’initiative des enquêteur·rices.
Pour déployer cette démarche dans votre école, différentes options permettent d’adapter sa mise en place à votre rythme, pour chacune des méthodes, en tant qu’étudiant·e, bénévole associatif, enseignant-chercheur.
Nous conseillons vivement d’associer des étudiant·es à la démarche, mais aussi des enseignant·es, des membres de l’administration et de la direction.
La collaboration avec des spécialistes des sciences humaines et sociales, qu’elle·ils fassent partie de votre école ou qu’elle·ils soient étudiant·es de l’université la plus proche est également recommandée.
Dans tous les cas, une équipe d’accompagnement est à votre disposition au niveau national pour vous aider à structurer et à réaliser ce projet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous : contact[@]asso-odfc.org
Vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de votre école, vous voyez un problème que vous souhaitez étudier ? Réalisez une étude autonome en étant accompagné par l'OFC !
Un stage ouvrier, technicien, fin d’études ingénieur, conventionné avec l’Observatoire
Un cours d’éthique, de RSE, de sciences sociales, etc.
Une recherche participative sous forme de projet d'étude co-construit entre l'école et l'OFC
↑
haut de page
En s’associant avec le monde de la recherche, l’Observatoire s’appuie sur une méthode en sciences humaines et sociales : la recherche-action. En principe, elle se déploie sur une phase de recherche, afin de comprendre une situation, et plus particulièrement les relations qu'entretiennent les acteurs de la situation, puis sur une phase d'action, dans laquelle la compréhension de la situation est mise en débat avec l'ensemble des acteurs afin d'identifier en commun les problèmes pour mieux les résoudre en respectant les besoins de chacun.
Qu’il s'agisse de conflits d'intérêt entre différents acteurs, de controverses entre représentations différentes de la situation, d'insatisfactions qui n'auraient pas été entendues jusqu'à présent, … la compréhension de la situation permet à l'ensemble des acteurs de s’accorder sur une représentation commune de la situation, de projeter des scénarii pour sa transformation afin d’expérimenter des solutions pour trouver la plus satisfaisante pour tous.
Différentes méthodes existent pour collecter des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, et qu'elles concernent les actions des participant·es ou les relations et les stratégies qu’elle·ils construisent pour les conduire, les connaissances et les opinions qu’elle·ils adoptent ou les valeurs et les intérêts qu'elle·ils portent. Faire appel à différentes méthodes permet d'observer un même objet – ici, la formation – sous différents angles.
Une fois produites, les données sont analysées dans le cadre des concepts choisis, ce qui conduit à expliquer les relations qu’elles entretiennent entre elles et avec le cadre conceptuel choisi. Les interprétations des résultats d’enquête peuvent amener à mieux percevoir et comprendre les désaccords entre les étudiant·es, les personnels de l’école, sur la vision d’un·e ingénieur·e idéal·e, ou encore à mesurer les écarts entre les objectifs de formation et les acquis des étudiant·es.
Au delà de d'observation et de l’analyse d’une situation, les méthodes d’enquête déployées permettent d'interpeller les personnes qui participent à ce travail, d’enquête en les amenant à se poser de nouvelles questions.
Un conseil scientifique permet d'assurer la pertinence de la démarche mise en place dans les école : Liste des membres du conseil scientifique
Questionnaires
Le questionnaire demande peu de temps aux participants et permet de toucher beaucoup de personnes, mais il ne leur offre que peu de liberté dans les réponses. Il nécessite par contre un long temps de préparation pour les enquêteurs.
Entretiens
L'entretien permet de saisir la complexité des situations vécues par les acteurs. En collectif, il rend compte des interactions entre les personnes.
Collecte de documents
Collecte des sites internet, des maquettes de cours, de l’évaluation CTI, ...
Questionnaires
L’analyse du questionnaire se fait par traitement statistique qui permet de croiser les données obtenues (variables dépendantes) avec certaines caractéristiques identifiées (variables indépendantes, telle que l’année de formation par exemple pour les étudiant·es).
Entretiens
L’analyse des entretiens se fait par analyse de contenu qui révèle les différentes positions des participant·es sur les thèmes étudiés, elle peut conduire à une catégorisation de profils types.
L'analyse de contenu permet également de traiter les informations des sites internet, des maquettes de cours, de l’évaluation CTI… en identifiant des éléments de langage et leur récurrence, la référence à certaines valeurs…
Appuis conceptuels
Les appuis conceptuels rendent l’agencement des données cohérent afin d’en faciliter leur restitution et la comparaison entre les différentes écoles.
Afin de favoriser la prise en main de ces outils, vous pouvez télécharger le guide d’animation et la maquette de cours ci-dessous
Du fait qu’elle interpelle les participant·es, l’enquête va susciter leur intérêt et leur curiosité : elle leur donnera peut-être envie d’aller plus loin et d’investir davantage la démarche. La restitution des résultats de l’enquête est une étape supplémentaire ; plusieurs supports peuvent servir à les transmettre (rapport envoyé par mail, panneaux d’affichage dans l’école, présentation lors d’une conférence).
Pour aller plus loin, ces résultats pourraient être discutés à minima dans les instances de gouvernance de l’école, et dans l’idéal avec l’ensemble des acteur·rices de l’école à l’occasion d’un événement à l’initiative des enquêteur·rices.
Pour déployer cette démarche dans votre école, différentes options permettent d’adapter sa mise en place à votre rythme, pour chacune des méthodes, en tant qu’étudiant·e, bénévole associatif, enseignant-chercheur.
Nous conseillons vivement d’associer des étudiant·es à la démarche, mais aussi des enseignant·es, des membres de l’administration et de la direction.
La collaboration avec des spécialistes des sciences humaines et sociales, qu’ils fassent partie de votre école ou qu’ils soient étudiants de l’université la plus proche est également recommandée.
Dans tous les cas, une équipe d’accompagnement est à votre disposition au niveau national pour vous aider à structurer et à réaliser ce projet. N'hésitez pas à prendre contact avec nous : contact[@]asso-odfc.org
Vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de votre école, vous voyez un problème que vous souhaitez étudier ? Réalisez une étude autonome en étant accompagné par l'OFC !
Un stage ouvrier, technicien, fin d’études ingénieur, conventionné avec l’Observatoire
Un cours d’éthique, de RSE, de sciences sociales, etc.
Une recherche participative sous forme de projet d'étude co-construit entre l'école et l'OFC
MENTIONS LÉGALES
L'Observatoire des Formations Citoyennes
© 2022
Conception :
Hugo Toulotte & Clara Choulet
CONTACT
contact[@]asso-odfc.org
MENTIONS LÉGALES
L'Observatoire des Formations Citoyennes © 2022
Conception : Hugo Toulotte & Clara Choulet